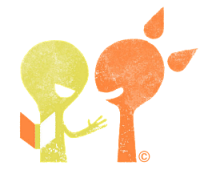Comprendre la source des préjugés : La vision occidentale d’une humanité unilingue
Ce paragraphe est issu du document L’enfant bilingue : chance ou surcharge ? de Georges Lüdi, université de Bâle. Il m’a semblé important de le reproduire (avec quelques coupes) afin d’avoir une notion « historique » du comportement occidental moderne souvent sectaire vis à vis du plurilinguisme. Il aurait été mal vu d’en faire une paraphrase.
« Les représentations sur le langage et le plurilinguisme sont profondément marquées, dans nos cultures occidentales, par deux filières de pensées traditionnelles :
- l’idée que l’humanité était une fois unilingue et que le plurilinguisme, résultat d’une “confusion”, pèse sur les hommes comme une malédiction divine depuis la construction de la tour de Babel (Genèse 11, 6-7); (Ajout, extrait du Monde Bilingue : Dans les temps bibliques la question des langues a connu des aspects dramatiques : c’est au moyen d’une langue unique que les hommes purent s’entendre pour élever une tour jusqu’au ciel, menaçant le créateur et sa création. Avec le recul de l’Histoire, la malédiction de Babel peut apparaître comme une bénédiction : en diversifiant leur langage, l’Éternel écartait la menace totalitaire d’une langue unique enfermant par avance les peuples dans la pensée unique).
- l’idée, apparue à l’époque de la naissance des états nationaux européens, que les ‘langues nationales’ représentent un facteur de cohésion privilégié des ‘nations’, que les ‘états’ coïncident nécessairement avec des territoires linguistiques, comme le suggérait déjà Antonio de Nebrija en 1492: “La lengua siempre es compañera del imperio“.
Ces deux traditions reposent sur le stéréotype selon lequel l’unilinguisme représente l’état originel des être humains, voulu par Dieu et/ou politiquement légitime. L’homme ‘idéal’ serait ainsi unilingue (de préférence dans une des grandes langues de culture occidentales (…).
Or, tous les grands empires de l’antiquité étaient plurilingues. Par ailleurs, les historiens ont démontré que les ‘nationes’ du début de l’ère moderne étaient des entités floues, sans langue ni constitution communes. Ce n’est que dans la période allant de la Révolution française à la 1ère Guerre mondiale et sous l’influence d’idées romantiques (voir par ex. Herder) qu’on commença à traiter les sentiments nationaux à l’image des affaires religieuses et d’en parler avec des métaphores empruntées à l’histoire sainte. (…) Aujourd’hui, des penseurs comme Umberto Eco s’interrogent avec beaucoup de raison sur l’obstination humaine à trouver une solution “unilingue” aux problèmes mondiaux de communication à l’aide d’une “langue universelle” et proposent de “réévaluer Babel” (Le Monde, 7 octobre 1994).
Dans le monde actuel aussi, la majorité des être humains est bi- ou plurilingue et/ou vit dans des communautés bi- ou plurilingues (Grosjean 1982, Baetens Beardsmore 1986), c’est-à-dire dans des sociétés caractérisées par l’emploi de plusieurs variétés linguistiques sur un seul et même territoire. Dans les années 80 déjà, on estimait que 60% de la population mondiale était affecté par l’une ou l’autre forme de plurilinguisme. Et il s’agissait des régions du monde caractérisées par les taux de croissance démographique les plus élevés. Ce n’est donc pas l’unilinguisme, mais bien le plurilinguisme qui représente le cas prototypique; le bilinguisme en est une variante, alors que l’unilinguisme représente un cas limite du plurilinguisme, dû à ces circonstances culturelles particulières.
(…) L’unilinguisme est, en fait, une déviation de la règle; l’unilinguisme est comme une maladie. Mais c’est, heureusement, une maladie contre laquelle il y a des remèdes efficaces: l’éducation plurilingue et l’enseignement plurilingue.
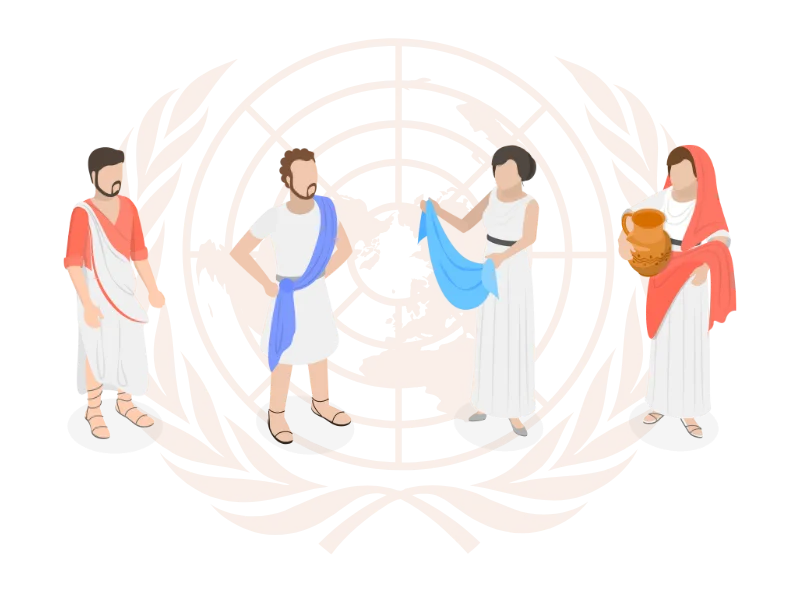
Nationes ?
Le terme latin “nationes” se réfère généralement aux groupes ou aux peuples qui partageaient certaines caractéristiques communes, telles que la langue, la culture, la religion ou l’origine géographique. À l’origine, le terme était utilisé dans la Rome antique pour désigner des divisions sociales, généralement basées sur l’origine géographique des citoyens. Les “nationes” étaient souvent des associations de citoyens romains venant de régions éloignées de Rome, qui se regroupaient pour des raisons sociales, politiques ou commerciales.
Cependant, au fil du temps, le terme “nationes” a évolué pour prendre un sens plus proche de ce que nous comprenons aujourd’hui par “nations” ou “peuples”. Dans un contexte historique plus large, “nationes” peut se référer aux groupes ethniques, culturels ou linguistiques qui ont émergé et se sont développés au sein des anciennes sociétés et qui ont joué un rôle dans la formation des identités nationales et culturelles.
La signification et l’utilisation du terme “nationes” peuvent varier en fonction du contexte historique et linguistique dans lequel il est employé.